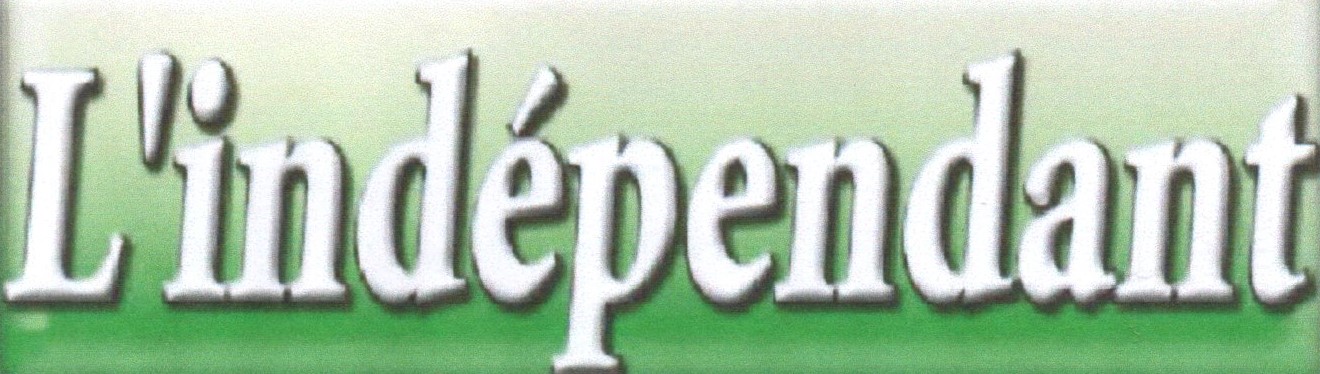L’Inde et le Pakistan se sont mutuellement bombardés, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et huit autres côté indien. Ce sont les violences les plus importantes entre les deux puissances nucléaires en deux décennies. Depuis que des hommes armés ont abattu 26 hommes au Cachemire indien le 22 avril 2025, le feu couvait entre les deux voisins, rivaux depuis leur partition en 1947. L’escalade diplomatique est donc devenue militaire dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juin. Décryptage avec Didier Chaudet, géopolitologue associé à l’Observatoire de la nouvelle Eurasie, spécialiste de l’Asie.
RFI : Cela fait un moment que les tensions sont vives entre l’Inde et le Pakistan au sujet du Cachemire. Est-ce que là, on atteint un niveau jamais vu ?
Didier Chaudet : On atteint un niveau important, mais en même temps quelque chose qui était attendu. Le gouvernement Modi a voulu reprendre en main le Cachemire depuis plusieurs années avec une idéologie d’extrême droite identitaire. Face à une population majoritairement musulmane, ça ne pouvait que poser des problèmes. Et du côté du Pakistan, le Cachemire, ça reste quand même leur « Alsace-Lorraine ». Donc, en fait, tout ça était attendu et les choses se sont passées presque comme on pouvait l’imaginer. Une attaque terroriste au Cachemire pour montrer que les Indiens ne tiennent pas si bien que ça le territoire.
Ça, c’était le 22 avril dernier, New Delhi dit avoir agi cette nuit en réaction à cet attentat dont vous parlez…
Et une réaction militaire, parce que Modi ne peut pas faire autrement par rapport à ses électeurs, par rapport aussi à l’opposition qui lui demandait des comptes et par rapport à sa propre idéologie. Donc là, on est dans une situation classique.
Alors, vous nous dites que l’Inde prépare en quelque sorte ce qu’il se passe là depuis quelque temps. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce regain de tension maintenant ?
En fait, l’attentat terroriste au Cachemire a été un déclencheur, encore une fois, montrant que l’Inde ne tient pas forcément si bien que ça le Cachemire. Il y a une réaction, du coup, par rapport aux électeurs de Modi… Et tout simplement des deux côtés du pays, on parle du territoire voisin comme étant occupé par l’autre. L’Inde aujourd’hui considère que la seule discussion qu’elle pourrait avoir avec le Pakistan sur le Cachemire, c’est sur les territoires qu’elle considère comme « occupés par les Pakistanais », l’Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan. Donc en fait, des deux côtés, on considère que la frontière est caduque, qu’il faudra un jour la changer en sa faveur. Bien sûr, l’attentat terroriste n’a été qu’un déclencheur de quelque chose qui est vraiment très ancré dans les têtes des élites des deux pays.
L’Inde et le Pakistan sont, on le rappelle, deux puissances nucléaires. Jusqu’où peut aller cette escalade concrètement ? Qu’est-ce qui, à ce stade, pourrait raisonner les deux pays ?
Ce qui pourrait raisonner les deux pays, c’est une implication notamment des grandes puissances pour pouvoir calmer les choses. L’idée selon laquelle les choses vont se calmer d’elles-mêmes, ça ne marchera pas vraiment. Ça n’avait pas véritablement marché par le passé et aujourd’hui, on est face à deux puissances nucléaires. Si vous avez un échange « limité » d’un point de vue nucléaire, entre l’Inde et le Pakistan, ça a un impact sur le climat, ça a un impact sur l’agriculture au niveau mondial, avec la possibilité d’un milliard de personnes qui souffriraient de famine à cause de cet impact. On ne peut pas considérer cette situation comme extérieure à nous, Européens, ou à nos communautés internationales.
Alors, vous parlez d’intervention de puissances extérieures… On a eu beaucoup de réactions dans le monde depuis ces dernières heures. Les États-Unis, par la voix de Donald Trump et de Marco Rubio, qui appellent à cesser l’escalade et à ouvrir un canal de discussion. La Chine aussi appelle le Pakistan à faire preuve de retenue. De quels leviers disposent ces puissances ? Quels moyens de pression ?
En fait, le problème, c’est que du côté américain, aujourd’hui, on est désorganisé. On ne veut pas s’impliquer comme acteur clé dans ces grands conflits. Il y a un repli qui ne veut pas dire isolationnisme, mais malgré tout, on n’est pas face à une administration qui pourrait prendre les choses en main de façon professionnelle. Du côté chinois, on a peut-être la possibilité de voir quelque chose arriver. C’est-à-dire que, à défaut d’avoir une puissance occidentale qui réussit à calmer deux partenaires, parce que les Américains connaissent bien les Pakistanais et les Indiens, on pourrait imaginer une sorte d’équilibre de la terreur où les Chinois font comprendre aux Indiens que, passé un certain nombre de lignes rouges, le Pakistan restant quand même un allié clé de la Chine, ils pourraient soutenir un peu plus fortement les Pakistanais. On ne sait pasi, dans les mois à venir, si les tensions continuent, si on ne verra pas la Chine déjà aider un petit peu en sous-main le Pakistan. On sait déjà que des avions indiens ont pu être abattus, y compris des Rafale, on parle de quatre ou cinq appareils. Si ça se confirme, on pourrait déjà imaginer que les Pakistanais profitent d’une aide militaire chinoise de plus longue durée qui a commencé bien avant la crise. Avant, c’était expliqué au conditionnel. Si ça se confirme, on pourrait passer à l’affirmatif.
Rfi